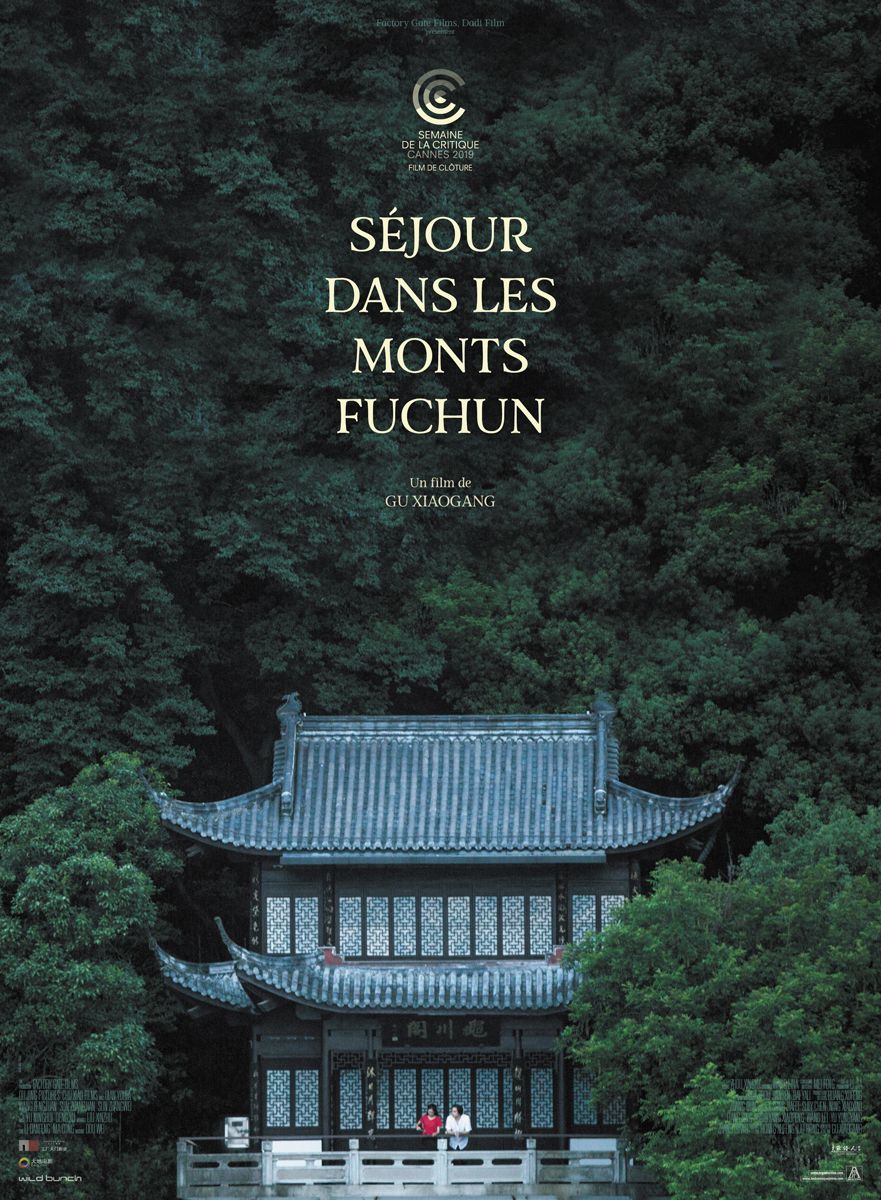Mostofa Sarwar Farooki est un réalisateur et producteur bangladais. C’est avec le film Third Person Singular Number (en bengali : থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ), avec l’actrice Nusrat Imrose Tisha dans son premier rôle au cinéma, qu’il réalise sa première percée sur la scène internationale en 2009. Le film est en effet présenté au prestigieux Festival International du Film de Pusan puis à Rotterdam.
Le long-métrage suivant de Mostofa Sarwar Farooki, Television, est d’ailleurs choisi pour être le film de clôture du Festival de Pusan en 2012.
Farooki est considéré comme « la figure de proue de la nouvelle vague bangladaise » selon Variety. Habitué des festivals, il vient de remporter deux prix au Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul avec son film Saturday Afternoon (Shonibar Bikel), actuellement interdit de diffusion au Bangladesh.

Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Qu’est-ce qui vous a amené à faire des films ?
Je ne me rappelle pas exactement comment cela a commencé. J’ai grandi dans un quartier typique de la classe moyenne du nom de Nakhalpara à Dacca. Les gens de de ce quartier sont de grands conteurs. Dans mon enfance, j’ai vu et entendu des centaines de conteurs incroyables dans les stands de thé du voisinage. Ils étaient assis là, des heures durant, à raconter toutes sortes d’histoires possibles et impossibles ! Dans ces échoppes de thé, ils racontaient la plupart du temps de fausses histoires particulièrement crédibles. Certains racontaient des histoires sur de riches parents, d’autres sur leur grandeur et fortune. Je me demandais pourquoi ils mentaient, sans trouver de réponse. En vieillissant, j’ai compris : ils mentent car les mensonges font parfois du bien à l’âme ! Le fait d’avoir grandi entouré de conteurs incroyables m’a probablement insufflé le goût de raconter, moi aussi, des histoires.
Je me rappelle aussi vaguement avoir manié un camescope quand j’étais au lycée. Je crois que c’était à quelqu’un dans ma famille. En revanche, je me souviens très bien de comment j’étais habillé et ce que j’ai fait avec la caméra ! Cette image est ancrée dans mon esprit de façon très vivante : je portais une chemise blanche avec les manches retroussées et j’essayais de faire un plan panoramique de la route devant la maison de mon oncle maternel. A un moment, un de mes cousins est venu voir ce que je faisais. Et il a commencé à me filmer. J’ai pris la pose d’un réalisateur, en feignant de cadrer quelque chose avec mes deux mains. Plus tard, j’ai réalisé que c’était une pose que j’avais subconsciemment empruntée à Satyajit Ray à partir d’une célèbre photographie de lui en tournage. Je n’ai pas fait d’école de cinéma à proprement parler ni bénéficié de l’expérience de quelque mentor. Je me suis juste jeté à l’eau et j’ai appris à nager ! En d’autres termes, je me considère comme un étudiant permanent de l’université universelle des erreurs : j’apprends de mes erreurs.
Y a-t-il beaucoup de cinéastes au Bangladesh, et en particulier des réalisateurs de films d’auteur ? Existe-t-il des écoles de cinéma au Bangladesh ? Comment devient-on cinéaste au Bangladesh ?
Il n’y a pas d’école de cinéma au Bangladesh. La plupart des réalisateurs apprennent auprès d’autres réalisateurs, en les assistant. Au début des années 80, il y avait un mouvement de cinéma indépendant dédié au court-métrage. Cela a permis, plus tard, à des films comme La Roue de Morshedul Islam (Chaka) de voir le jour -Apichatpong Weerasethakul en a parlé comme un de ses 50 films préférés. Et ce mouvement a aussi permis à des réalisateurs tels que Tareque Masud de se faire remarquer -son film L’oiseau d’argile (Matir moina) était présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2002. Ce mouvement n’a pas perduré mais il a influencé une nouvelle génération de réalisateurs, qui ont profité de l’évolution de l’outil numérique et de la prolifération des chaînes de télévision par satellite au Bangladesh. J’appartiens à cette génération. Nous avons commencé à faire des courts-métrages ou des téléfilms pour la télévision. C’était en quelque sorte une école car nous nous sommes servis de cette expérience pour trouver notre propre style cinématographique. Cela a provoqué un changement radical au niveau aussi bien du goût du public que dans le style visuel des réalisateurs. Pendant ce temps, certains de nos films ont été présenté dans des festivals de films internationaux de catégorie A tels que Toronto et Rotterdam. Il y a eu une accélération avec la sélection de mon film, Television, comme film de clôture du Festival de Pusan en 2012. Beaucoup de jeunes réalisateurs commencent à émerger, avec des idées nouvelles, des rêves et des espoirs.
Et bien qu’il n’y ait pas vraiment d’écosystème de nature à soutenir la création locale, je suis convaincu que le cinéma bangladais va créer la surprise dans les années à venir, grâce à l’esprit combatif des plus jeunes réalisateurs.
Comment les cinéastes bangladais financent-ils la production de leurs films ? Existe-t-il des producteurs au Bangladesh ?
Le financement est un vrai problème. Nous avons très peu de financement (et de financeurs) pour les films indépendants. Le gouvernement soutient parfois certains films ou certaines personnes, selon des critères « très spéciaux »… En gros, le terme de « producteur » tel que vous le connaissez n’a rien à voir avec le fonctionnement de l’industrie cinématographique bangladaise. Au Bangladesh, on appelle « producteurs » les personnes qui financent le film, qui apportent ou trouvent de l’argent. Et la plupart du temps, les réalisateurs travaillent en tant que producteurs non crédités sur leurs films. Bref, c’est vraiment très compliqué…
Pour vous donner une idée du budget moyen de mes films, le budget de Television était d’environ 300,000 USD. Et pour Saturday Afternoon, qui a été présenté au Festival de Pusan l’année dernière et qui vient de remporter deux prix au Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, c’était environ 400,000 USD.
Combien de films indépendants (tels que les vôtres) sont produits chaque année ?
A un moment donné, c’était trois à quatre films par an. Maintenant c’est descendu à un ou deux.
Globalement (en incluant les films commerciaux), il pouvait y avoir jusqu’à 52 films produits dans l’année. Maintenant, il n’y en a plus qu’une vingtaine, en dépit de l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes réalisateurs.
Vos films sont-ils sortis en salles au Bangladesh ? Si oui, comment a réagi le public ?
Oui, tous mes films sont sortis en salles au Bangladesh et sont particulièrement suivis par un public plutôt jeune. Mais la censure est un vrai problème. J’ai réalisé 7 longs-métrages jusqu’ici. Sur les sept, cinq ont été censurés ! Maintenant, cela commence à me fatiguer. J’espère que cela ne nuira pas à ma spontanéité créative… C’est vraiment éreintant.
En janvier 2019, le Bureau de Censure bangladais a interdit la diffusion de mon dernier film, Saturday Afternoon. Une décision qui relève d’un véritable mystère pour moi ! Après le visionnage du film par le Bureau de la censure, ils m’ont appelé pour me dire qu’ils ont apprécié le film. Certains d’entre eux ont même fait des interviews dans la presse locale, en disant du bien du film et en parlant d’un visa imminent pour sa diffusion. Deux jours plus tard, j’ai commencé à voir une campagne sur internet par des prêcheurs islamistes qui demandaient l’interdiction du film. En 24 heures, ces vidéo islamistes ont été partagées des milliers de fois. Elles racontaient n’importe quoi, le film n’avait même pas été regardé correctement ! Deux jours plus tard, le Bureau de censure a appelé pour demander un second visionnage exceptionnel, suite auquel ils n’ont pas délivré l’autorisation de diffusion. Nous avons fait appel, la procédure est en cours.
Comment définiriez-vous le cinéma bangladais ? Existe-t-il une identité culturelle spécifique ? Une histoire ou une évolution précise ?
Le cinéma bangladais a typiquement toujours été une copie soit du cinéma commercial indien, soit du cinéma d’auteur de Kolkata (Satyajit Ray, Ritwick Ghatak, Mrinal Sen etc.). Il y a quelques exceptions, mais c’est le tableau général. Quand les plus engagés d’entre nous avons commencé à faire des films, nous avons décidé de défier ce paradigme. Nous voulions suivre notre instinct, notre cœur. Nous nous sommes inspirés de notre quotidien. Nous avons rejeté le jeu d’acteurs stylisé/spectaculaire traditionnel. Nous nous sommes débarrassés des dialogues écrits ou artificiels. Et cela nous a permis de gagner le cœur d’un public jeune, mais ce faisant cela a attisé le courroux de l’establishment. Alors beaucoup de débats ont commencé à faire surface concernant le recours au dialogue, l’accent bengali, le choix des sujets… Le bon côté des choses c’est que cela a permis au cinéma bangladais de s’intéresser à des sujets plus personnels. Nos films ont commencé à refléter nos personnalités. Je pense que si nous continuons tous ainsi à faire des films, davantage de films, nous parviendrons à une forme d’identité collective du cinéma bangladais.
Comment définiriez-vous votre propre style cinématographique, votre vision en tant qu’auteur ?
A dire vrai, je préfère laisser le public et les critiques en juger. Tout ce que je peux dire c’est que je suis un explorateur, j’aime expérimenter. J’aime aussi quand mes acteurs oublient complètement qu’ils sont devant une caméra, car c’est à ce moment-là qu’on touche à la vérité dans son état le plus authentique. Pour Saturday Afternoon, la tension psychologique était palpable chez les acteurs. Leur jeu a commencé à devenir beaucoup plus instinctif au bout d’un moment, en fait ils ne jouaient plus ! Un des acteurs (qui joue le rôle de Mojammel Huq) s’est vraiment senti mal à cause de l’intensité de son rôle et a fait de l’hypertension ! Il a dû être hospitalisé juste après le tournage…
Les critiques parlent souvent d’un mouvement Chabial que vous auriez fondé, défini comme un mouvement de cinéma bangladais d’avant-garde. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Chabial c’est ma société de production, en fait. Les films que nous avons réalisés ont peut-être eu un impact sur une narration visuelle bangladaise plus traditionnelle en revendiquant une approche plus personnelle et le recours à l’humour, la fantaisie, l’absurdité, l’émotion. Peut-être est-ce à cela que les gens font référence en parlant de Chabial. Il est vrai aussi que j’ai formé un bon nombre de jeunes réalisateurs, qui ont fait leurs armes en travaillant sur mes films. Cela a permis d’injecter de l’énergie et du sang neuf dans l’industrie !
Quel est le dernier film que vous avez vu qui vous a le plus marqué ?
Au risque de paraître « mainstream » au regard des 4 Oscars récemment remportés par le film, c’est Parasite ! Même si ce n’est probablement pas le meilleur film de Bong Joon-ho, ce qui est remarquable c’est tout simplement son talent de metteur en scène : si le même scénario avait été réalisé par un autre réalisateur, le film aurait eu toutes les chances d’être stéréotypé, didactique et vain ! La maîtrise et le talent de Bong Joon-ho, de nature à rendre le film parfaitement fluide et crédible, sont ici juste incontestables.
Propos recueillis par Françoise Duru